Par Ali Tahmasebi[1]
Les mots et les objets existent parce que nous existons. Ce sont les locuteurs, surtout lorsqu’ils parlent, qui donnent vie aux objets, aux actions et à l’univers. Du moins, c’est littéralement le cas dans Amatka, où les objets sont confirmés dans leur existence par le mot qu’on utilise pour les identifier. L’auteure Karin Tidbeck travaille ainsi l’importance des mots dans son roman de réalisme magique, dont elle a elle-même écrit les deux versions originales, suédoise et anglaise[2].
Vanja, la protagoniste du roman, occupe un poste désenchantant, aux tâches répétitives, dans la société imaginaire dont Amatka est l’une des rares villes, celle la plus au nord. La langue qu’on parle dans ce monde est en train de se dissoudre, sans que la population s’en rende vraiment compte, alors qu’on se débarrasse des mots les moins utiles. L’État désire enlever les mots qui sont de trop, pour ne conserver que le nécessaire, dans un effort visant à cacher aux gens qu’on peut, avec beaucoup d’effort, transformer un objet en un autre si on lui attribue un nouveau nom.
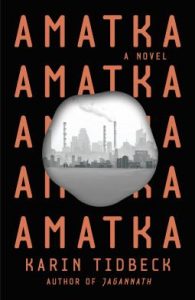
Crédit: Lisa Wool-Rim Sjöblom
Le roman arrive à montrer comment on réussit à bâtir un univers autour de nous en utilisant certains mots et certains sons. L’univers d’Amatka est tissé dans une réalité à la texture instable, et il est nécessaire de « rappeler » aux objets ce que leurs utilisateurs veulent qu’ils soient, sinon ils perdent leur « réalité » et se transforment en une sorte de pâte visqueuse. Plusieurs éléments du réalisme magique résonnent donc dans ce roman : on y retrouve le cas des deux univers superposés, avec un univers bien tangible qu’on reconnaît comme « normal » et celui, en apparence magique et mystérieux, plus fugitif mais bel et bien là. De plus, la frontière entre ce qui est « magique » et ce qui est « réel » est floue. Il est difficile de distinguer ce qui est vraiment réel et ce qui l’est, mais autrement. Conséquemment, ce sont les individus eux-mêmes qui définissent cette frontière, en parlant, donc en fixant la vie des objets. Plus cette ligne entre la magie et la réalité est proche de ce qui est considéré comme normal, plus le gouvernement sent qu’il est stable, qu’il est en sécurité, donc en contrôle de la situation. Cependant, tout effort visant à déplacer cette frontière entraîne de graves conséquences pour les individus assez braves – ou fous – pour nommer un crayon autrement que… « crayon ».
Par ailleurs, le livre nous amène vers un rejet de l’autorité, et nous rappelle le rôle important du livre dans cette entreprise. Le gouvernement (the Commune dans le texte) recherche l’ordre et la sécurité en limitant l’information accessible aux citoyens et en normalisant et réduisant le vocabulaire autorisé. Or, la première fois où on assiste à une réaction contre ce système, aussi secrète soit-elle, c’est un bibliothécaire qui en est l’instigateur! Ce dernier est présenté comme le gardien des livres, comme le protecteur du savoir et de la culture. On sent la dénonciation du peu d’attention bien réelle que nos législateurs accordent à l’éducation, aux arts et à la culture, sans parler des conséquences destructrices que cela a sur la communauté. Plus encore, la personne qui vient au secours de la société d’Amatka s’avère être une poète : Tidbeck sous-entendrait-elle que seuls les artistes et les créateurs pourront sauver notre société? Un gouvernement qui choisit de brûler ses livres pour se sauver, on a déjà vu ce que ça donne : c’est plutôt lui-même qu’il réduit en cendres.

Crédit: Andreas Ingefjord
[1] Je me suis souvent référé, en écrivant ce texte, à l’article « Scheherazade’s Children : Magical Realism and Postmodern Fiction » de Wendy B. Faris, et à « The Question of the Other: Cultural Critiques of Magical Realism ». Dans ces articles, Faris place le réalise magique dans un contexte historique, social et littéraire et elle définit les principales caractéristiques de ce genre, ainsi que ses caractéristiques secondaires.
[2] Une traduction en français a été publiée en mars 2018 aux éditions La Volte.
