La Femme aux semelles de temps, sortit le 6 avril dernier, est le dernier recueil de nouvelles de la Grande Dame de la science-fiction québécoise, Élisabeth Vonarburg. Ce recueil explore, en sept nouvelles remarquables, notre futur avec une proximité humaine délicieuse, offrant un rafraichissement à un genre trop souvent stéréotypé au grand spectacle. C’est un merveilleux voyage dans nos futurs alternatifs, réfléchi avec une grande pertinence, que m’ont fait vivre ces sept nouvelles aux relents de fantasy, à l’humanité tangible et à la poésie assumée.
On y sera dans l’espace, à la rencontre d’un homme prisonnier d’un grand cristal pour une courte histoire d’amour. On y sera mis devant la peur des chutes d’un oiseau-machine née des mots. On assistera à l’élaboration d’un monde où la musique est reine, où toute l’histoire doit encore être écrite. On sera par deux fois transporté dans deux contre-utopies environnementale situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On assistera au bouleversement de la vie de gens ordinaires dans un monde où tout est réglé.
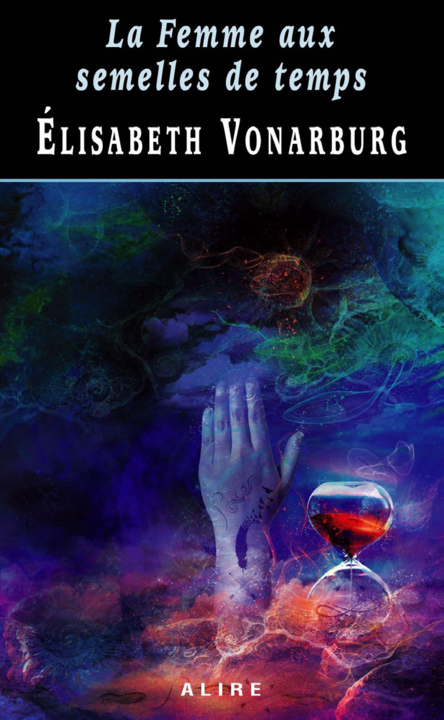
C’est le livre idéal pour découvrir son auteure, autant pour les connaisseurs du genre que les néofit, considérant qu’il regroupe des textes issus de plusieurs moments de sa carrière, offrant une plongée merveilleuse dans son style unique mêlant habilement science et poésie. De plus, chaque nouvelle est signée d’une postface vous expliquant l’origine du texte ou développant davantage le questionnement des thématiques abordées, renforçant ainsi l’invitation à la découverte.
Autres aspects que j’ai grandement apprécié : la forte présence de régionalisme et, plus généralement, de la vie quotidienne à travers les récits proposés. On y suit le quotidien de personnes qui, sous toutes les coutures, n’ont rien de grands héros, des gens à qui il est facile de s’identifier, des gens qui font leur boulot, des gens qui vont chez le médecin, des gens qui retournent chez eux, des amateurs de courses et d’engagements politiquement, des créateurs, etc. Le meilleur exemple est trouvable dans « Into White ». Ici, on suit une mère et son enfant, atteint d’un cancer, qui a la capacité d’illuminer. Or, on se concentre sur la mère, Trish, sur sa relation avec l’enfant et comment cet enfant s’inscrit dans ce monde qu’elles paratagent à l’humanité toute entière, soit exactement là où une certaine tendance en littérature de genre aurait été d’explorer le monde via la subjectivité même de l’enfant extraordinaire. Dans ces nouvelles règne l’humain dans son être et ses relations, et ce, alors que s’opère tout de même un dépaysement incroyable; il nous est donné à explorer des quotidiens qui ne seraient jamais s’approcher du nôtre, alors même qu’ils sont si près.
Entrevue
Mais qui est donc Élisabeth Vonarburg ? À qui est-ce que je m’adresse en ce moment ?
Je l’sais tu, moi (haha) ? Ça fait au moins 60 ans que je me pose la question ! Et bien, je suis une Française née en 1947, immigrée au Québec en 1973 et qui a donc connu trois générations de féminismes (ce n’est pas peu dire). J’étais une petite fille très curieuse (et, donc, très emmerdante). C’est surement pourquoi j’écris aujourd’hui de la science-fiction.
Vous écrivez depuis combien de temps?
Depuis mes sept ans, je crois. Mon tout premier texte était de la poésie qui rimait, en alexandrins. Je m’y suis reprise depuis, quand même (haha). À 15 ans, j’ai découvert le vers libre. C’était trop difficile pour moi, trop près de moi, aussi. Mais, en même temps, j’ai découvert la science-fiction (youpi !) ce qui m’a permis de continuer à écrire.
En effet, j’ai cru lire sur votre site Internet que vous êtes rentré en contact avec le genre presque directement avec les premiers écrits des monstres actuels du genre comme Dick ou Herbet…
Oh, non. J’étais jeune adulte, à cette époque. Mais, à 15-16 ans, j’ai eu la chance d’avoir accès aux textes de genre de l’âge d’or, soit ceux des années 30 à 60. J’ai eu accès à un vaste éventail de thèmes, de styles, et de genres — ce que n’a pas forcément tout le monde.
Immigré ici en 1973, la relation que vous entretenez au Québec influence-t-elle votre manière d’approcher ou d’écrire votre science-fiction ou, plus généralement, les thématiques que vous abordez dans vos œuvres ?
Ah, la littérature migrante… Nous sommes tous en voyage. Bon, y en a pour qui c’est beaucoup plus clair et pénible que d’autres, mais nous sommes tous, d’une manière ou d’une autre, déraciné. Il est certain que si l’on n’a jamais bougé de chez soi, le déracinement va s’exprimer ailleurs. D’une façon ou d’une autre, on est toujours un peu à côté de ses pompes (haha). Immigrer met en jeu tout un tas de choses : ça met en jeu vos facultés d’adaptation, ça met en jeu vos facultés d’ouverture, ça met en jeu vos facultés de métamorphoses…
Et, une fois que j’ai dit ça, la science-fiction m’est évidente, puisque le motif principal de la science-fiction, selon moi, c’est la métamorphose, le changement, la différence ! Le rapport à l’autre, c’est le grand mouvement de la science-fiction.
Alors le thème du voyage, oui, mais pas nécessairement pour aller dans l’espace. On peut aller dans l’espace intérieur, on peut voyager dans le temps, en soi, dans d’autres consciences… C’est la multiplication des expériences de vie ! C’est ce que fait toute la littérature, mais nous le faisons de façon un tout petit peu « baroque », un petit peu bizarroïde.
Après une si longue et prolifique carrière, on doit surement saisir quelques thèmes et éléments récurrents propres à son style. Quels sont les vôtres dans ce recueil ?
Je pourrais vous faire un beau diagramme avec toutes les branches : l’autre, le féminin, le masculin, l’autre conscience, les intelligences artificielles, les consciences artificielles – ce qui n’est pas du tout la même chose –, l’appropriation culturelle, les mythes… Pour faire court, je dirais : l’autre, la différence et la métamorphose. Ce sont ceux-là, mes obsessions et c’est déjà extrêmement vaste.
Mais il y a aussi des obsessions moins philosophiques. Des images qui reviennent, ma vie personnelle et mes expériences. En gros, le mythe personnelle de l’auteur. Ça va aller nourrir les images, les métaphores et les comparaisons que je vais utiliser pour communiquer avec le lectorat qui n’a pas forcément les mêmes expériences. Et ça, c’est le beau travail de l’écriture.
Si vous deviez garder que trois livres parmi tous ceux qui vous ont influencés, lesquels seraient-ce?
Oh, là, là… je déteste cet exercice (haha) !
1) Je dis toujours La Main gauche de la nuit, de Ursula K. Le Guin, parce qu’elle a cristallisé tout un tas d’impressions et de sentiments confus que j’avais depuis plusieurs années (publié en 1969) à propos de la place du féminin dans la science-fiction.
2) Il y a eu Dune, parce qu’il m’a donné la permission. Ils sont importants, les livres ou les gens, qui vous donnent la permission d’écrire ce que vous voulez l’écrire. Quand j’ai commencé à écrire le Cycle de Tyranaël, je ne savais pas si j’avais le droit. Un cyle en cinq volume se déroulant sur des planètes lointaines avec des thèmes écologiques. Je voulais l’écrire et c’est tout. Dune m’a fait comprendre : « Ah oui, mais on a le droit de le faire-ça ! »
3) Et en troisième, je vais dire Tolkien. Pas pour le contenu irréel, mais pour l’aspect linguistique de sa création. C’est tellement important, dans les genres, les néologismes (la science-fiction en est pleine), l’invention de langages, la réflexion sur le langage, invention du monde par langue, etc. Que ce soient les petits bouts de langues différents que l’on va mettre dans une société du futur pour montrer comment ça a évolué, quelle est la réalité quotidienne des gens, quel est le nom des objets, des concepts, etc., voire même le contact avec des non-humains : quel langage ont-ils, quels concepts ont-ils, en quoi sont-ils différents, pouvons-nous les comprendre, jusqu’à quel point nous ne les comprenons pas et que ça crée des horribles malentendus… Bref, l’invention linguistique !
Voilà, j’ai enfin réussi à y répondre !
La Femme aux semelles de temps contient des nouvelles renvoyant à des époques antérieures dans votre carrière. Comment avez-vous approché ce nouveau recueil ?
C’est moi qui décide de l’ordre de mes textes et tout dépend de ce qu’ils me disent. par exemple, trois des textes ont été écrits sur commande : « Into White » (« Apocalypse Nord », Six Brumes), « La Course de Minuit » (« Hypermondes : Utopies », Moutons électriques) et « La Femme aux semelles de temps » (Solaris Printemps 2023).
« La Femme aux semelles du temps » est née à partir d’une contrainte d’atelier. J’organise des ateliers mensuels d’écriture d’une journée et, une fois, la contrainte était l’image d’une semelle avec des symboles dessus. Ça m’a aspiré (littéralement).
« Into White » a été écrit pour un collectif qui ne voulait pas être trop glauque et j’ai donc essayé de faire le truc le plus positif que je pouvais à ce moment-là – c’était ce que je pouvais faire de mieux. Aussi, c’était un collectif de nouvelles qui se déroulaient chez moi, au Saguenay ! Ça m’a permis de créé un monde saguenéen du futur que j’ai repris, cinquante ans plus tard, dans « La Course de Minuit ». Je pouvais causer québécois, je pouvais parler chez moi, écrire chez moi et je pouvais me défouler de chez moi (haha). J’ai aimé ça ! Au tout début de ma présence dans le milieu de la science-fiction, je me disais: « Bon sang, pourquoi n’y a-t-il rien du Québec dans la SF ? » Ça s’est quand même arrangé depuis, mais je me suis toujours débattu avec ça.
Vous qui avez opéré chez Solaris, qui avez, en quelque sorte, vu naître la science-fiction au Québec, comment décririez-vous l’état actuel du genre au Québec?
(J’ai non seulement vu naître, mais participé à la naissance, ce qui me rend pas mal contente, coudon).
Actuellement, le genre recommence à se porter plutôt bien, je crois – circonstances, tout ça. En fait, ça va, ça vient. Modes. Parfois le fantastique prend le dessus chez le public, ou la fantasy. En général, à part l’engouement apo/post-apo/dystopie sur lequel s’ébattent pas mal d’auteur.e.s plus ou moins tangentiels, le genre est souvent mâtiné de fantasy, de la « science fantasy ». La science-fiction « pure et dure » a assez peu de pratiquants au Québec, à part Daniel Sernine (qui pratique encore davantage le fantastique), Alain Bergeron (dans le temps), Jean-Louis Trudel et Yves Meynard (mais ce dernier préfère clairement la fantasy). Le problème, c’est que c’est un genre très dépend des plates-formes de publication et il n’y a qu’un seul éditeur vraiment spécialisé en science-fiction au Québec : Alire. On vient de se lancer dedans chez VLB, mais il faudra voir quel(s) (sous)genre(s) de science-fiction. D’ailleurs, il n’y a pas non plus beaucoup de revues où publier des textes de genres. C’est embêtant pour les écrivaines. zévains qui voudraient s’essayer – et il me semble qu’il y en a de plus en plus, et en particulier des jeunes écrivaines !
Dans certaines des nouvelles de ce récueil une forme d’espoir transparait. Est-ce qu’insuffler de l’espoir dans votre travail est volontaire ?
Pour le cas des écritures sous contrainte, j’ai essayé. Franchement, ça ne va pas très loin. Je suis une pessimiste lucide. Mon mantra est « Tout est possible, même le meilleur, et rien n’est certain, même le pire » et ça me parait être pas mal la devise de la science-fiction. On joue avec les possibles, du pire au meilleur, mais on n’est pas là pour dire « ça va être terrible, horrible, affreux, abominable »; on est là pour proposer des situations diverses et imaginaires, en invitant le lectorat à se positionner intellectuellement, spirituellement et affectivement. C’est pour aider les gens à réfléchir et aussi à ressentir : c’est ça, le truc de la science-fiction. Lorsque l’on parle d’espoir, ça devient vraiment précieux. Il ne s’agit pas de désespérer, mais de comprendre ce qui se passe et de décider comment on se situe par rapport à ça. Quand on écrit sur des sociétés parallèles, on apporte toujours des solutions ou des hypothèses de solution qui, à leur tour, sont toujours remises en cause par telle, ou telle, ou telle découverte scientifique. Je trouve ça très, très excitant !
Plusieurs des nouvelles de votre recueil se déroulent dans un futur spécifique — comme « Into White », située aux alentours de 2050. Je sais qu’il s’agit d’une sorte de tradition, voire de permission, émise par la science-fiction, mais avec le dérisoire futur proche de Back to the Future située en 2016, le grand public s’est mis à gentillement moquer ce trope. Selon vous, est-ce mettre une date aussi précise ou proche à un futur fictionnel revient à apposer une date de péremption à votre œuvre ? Très pertinente question. L’obsolescence programmée est l’une des raisons pour lesquelles (outre mes ignorances scientifiques) je n’écris pas de technofine pointe, ladite fine pointe s’émoussant assez vite. Aussi, je n’ai pas tendance à écrire des histoires qui se passent clairement dans le futur d’ici et maintenant (i.e. de la prospective). En réalité, très peu d’auteur.es.s le font. Ce que nous faisons, c’est écrire des histoires qui se déroulent dans UN futur que nous considérons comme possible, à partir d’éléments du maintenant tels que nous les choisissons plus ou moins capricieusement selon nos propres préoccupations. De toute manière, dès que la date indiquée est dépassée, l’histoire bascule sans équivoque dans un univers parallèle. Après tout, on lit encore Verne, et Wells, et Clarke même si nous ne sommes plus au XIXe siècle ni en 2000, ni même en 2010 !
